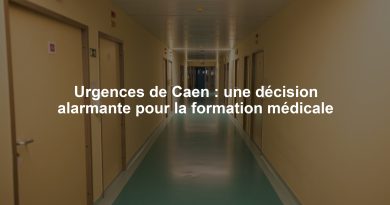Scandale du don d’organes aux États-Unis : des prélèvements effectués alors que le patient revient à la vie
Mise à jour le 2025-11-21 16:35:00 : Une enquête révèle des pratiques douteuses au sein du système de don d’organes du New Jersey.
Alerte : Aucune confirmation indépendante n’a pu être obtenue à partir de sources fiables. Cette information est à considérer avec prudence.
Aux États-Unis, la transparence autour du don d’organes est ébranlée par des révélations accablantes. La Commission Ways and Means de la Chambre des représentants enquête sur le “New Jersey Organ and Tissue Sharing Network”, un organisme de gestion des dons, à la suite d’accusations inquiétantes.
Des lanceurs d’alerte parlent de manipulation de documents, de consentement des familles douteux, voire d’élimination massive d’organes. L’affaire la plus choquante concerne un patient de Camden (New Jersey), déclaré mort, mais qui aurait repris conscience alors que la procédure de prélèvement avait commencé.
Une enquête parlementaire face à des allégations lourdes
Selon la lettre adressée par la commission à la direction de la NJ Sharing Network, plusieurs lanceurs d’alerte affirment qu’un patient déclaré décédé s’est “réveillé” alors que l’équipe de prélèvement avait déjà démarré l’intervention.
D’après ces témoignages, la dirigeante de l’organisme, Carolyn Welsh, aurait ordonné la poursuite du prélèvement, malgré les inquiétudes du personnel hospitalier. Finalement, c’est le staff de l’hôpital de Virtua Our Lady of Lourdes, à Camden, qui a interrompu la procédure.
Le “syndrome de Lazare” : quand le patient revient à la vie…
L’affaire du patient qui se serait “réanimé” pendant le prélèvement est décrite comme un cas de “syndrome de Lazare“. Ce terme emprunté à la Bible est une référence à Lazare, ressuscité par Jésus. Ce phénomène, bien que rarissime, correspond à des reprises d’activité cardiaque après une déclaration de mort.
Pour expliquer ce type de situation, le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, revient sur la marge d’erreur possible lors du constat de décès.
“Le diagnostic de décès est clinique, quasiment empirique. En effet, il n’y a pas un examen complémentaire, comme une radio ou une prise de sang, pour poser ce diagnostic. Ce dernier repose, en pratique, sur un ‘faisceau d’arguments’ comme l’absence de pouls, de respiration ou d’activité électrique du cœur (électrocardiogramme plat)”.
Il rappelle donc les erreurs possibles. “On se méfie beaucoup des bradycardies profondes, qui se caractérisent par un rythme cardiaque tellement bas que le pouls peut paraître absent, des intoxications médicamenteuses ou encore de l’hypothermie, qui peuvent faire conclure à tort au décès alors que la personne n’est pas morte”.
Ces remarques rappellent combien le constat de la mort est une décision lourde de conséquences, et combien un diagnostic erroné peut déclencher des scénarios tragiques.
Des accusations graves qui menacent la confiance dans le système de don
Face à ces révélations, des voix s’élèvent pour réclamer des réformes profondes. L’enquête de la Chambre des représentants pourrait aboutir à une révision des protocoles de prélèvement. Mais aussi à un renforcement du contrôle des procédures médicales et une plus grande transparence envers les familles. Certains parlementaires évoquent même des sanctions, des audits réguliers, voire une refonte du rôle des organismes de prélèvement.
Cette affaire ébranle la confiance dans un système dont le fondement est le don volontaire et la solidarité. Si ces allégations sont confirmées, elles pourraient non seulement entraîner des sanctions pour la NJ Sharing Network, mais aussi un véritable tournant dans la manière dont les organes sont récupérés et redistribués aux États-Unis.
1. Comment la France évite-t-elle les erreurs lors du constat de décès ?
En France, le décès est confirmé par un médecin selon des critères précis. Le contrôle est strict. Le praticien vérifie l’absence totale de conscience, de respiration et d’activité cardiaque. En cas de doute, il prolonge l’observation. Les situations à risque, comme l’hypothermie ou certaines intoxications, sont surveillées. Ces précautions limitent fortement les erreurs.
2. Quelles garanties encadrent les prélèvements d’organes en France ?
Le prélèvement suit un protocole national très encadré. L’Agence de la biomédecine supervise tout. Les équipes hospitalières doivent vérifier une deuxième fois les critères médicaux avant tout geste. Chaque étape est tracée. Les familles sont informées. Les audits sont réguliers. Ce système limite les dérives observées ailleurs.
3. Peut-on avoir confiance dans la chaîne de don d’organes française ?
Oui, car le système repose sur un contrôle indépendant. Les hôpitaux déclarent chaque prélèvement. L’Agence de la biomédecine vérifie les dossiers. Les pratiques sont harmonisées. Les médecins reçoivent une formation spécifique. En cas d’incident, une enquête est ouverte automatiquement. Cette transparence renforce la confiance des familles et des donneurs potentiels.
Sources

Source d’origine : Voir la publication initiale
Date : 2025-11-21 16:35:00 — Site : www.doctissimo.fr
Auteur : Cédric Balcon-Hermand — Biographie & projets
Application : Téléchargez Artia13 Actualité (Android)
Notre IA anti-désinformation : Analyzer Fake News (Artia13)
Publié le : 2025-11-21 16:35:00 — Slug : scandale-du-don-dorganes-aux-etats-unis-des-chirurgiens-realisent-un-prelevement-alors-que-le-patient-revient-a-la-vie
Hashtags : #Scandale #don #dorganes #aux #ÉtatsUnis #des #chirurgiens #réalisent #prélèvement #alors #patient #revient #vie